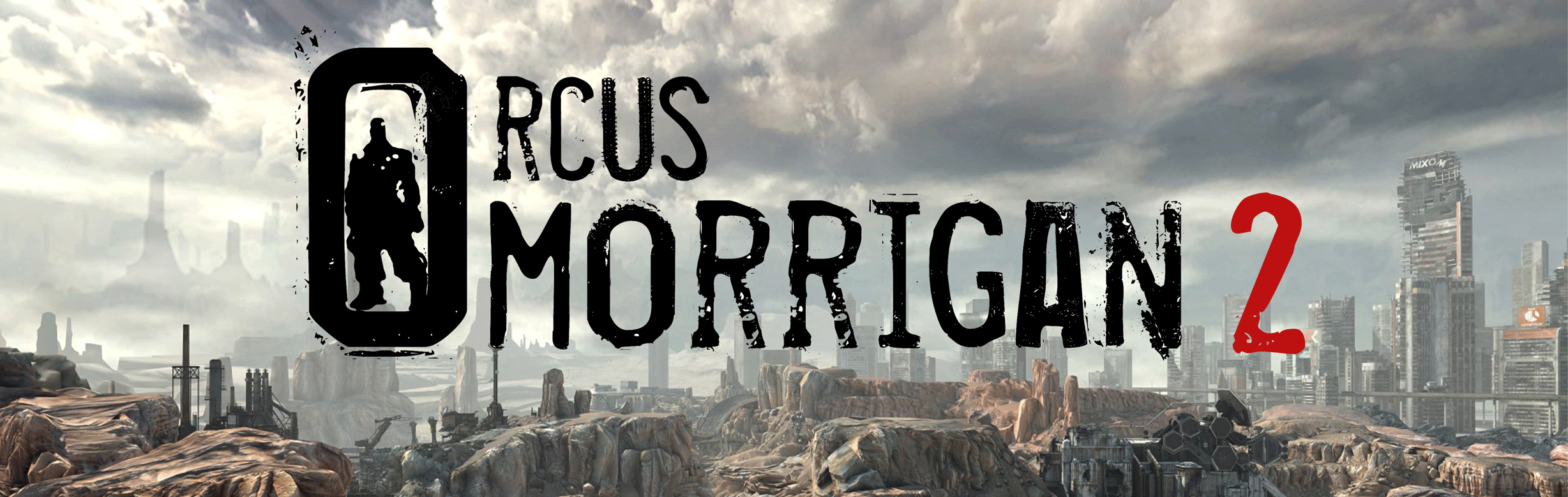Je pourrais commencer ce chapitre façon Flaubert : « C’était à Wuhan, province du Hubai, dans les jardins de Yi de Zeng. »
Ou plus pragmatique, à la Ponson du Terrail : « Après avoir erré des heures dans la forêt, nos deux héros arrivèrent dans les faubourgs de Wuhan. »
Parce qu’en réalité, vous expliquer comment nous trouvons la ville de Wuhan, honnêtement, ça vous intéresse vous ? Que je vous narre dans le détail nos plombes d’errance dans la forêt, les rizières, le comment qu’on a longé le Yang-Tsé, rivière impétueuse charriant des torrents de boue, tout ça, bien naturaliste ?
Vraiment ?
Bon, c’est bien ce qu’il me semblait, tout le monde s’en cogne, moi le premier. En plus, Wuhan, c’est plus de onze millions d’habitants. Donc j’aime autant vous dire que c’est pas le petit village paumé en pleine cambrousse, et qu’on a eu le temps de voir fleurir les premiers signes de la civilisation bien des kilomètres avant d’atteindre le centre-ville.
Trouver Wuhan n’était pas difficile. En revanche, dans une ville aussi tentaculaire, localiser un marché où on vend du pangolin farci, c’est déjà plus dur. Mais mon appréhension principale, c’est comment ne pas nous faire repérer.
Nous avons pris soin de cacher autant que possible nos gueules décomposées sous nos fringues, et nous gardons nos mains desquamées dans nos poches. Mais si Tokū, de loin, peut encore faire illusion, mon presque double mètre et mon look de Caucasien vont forcément attirer l’attention.
Pourtant, il n’en est rien. Nous déambulons dans des artères grouillantes sans que personne ne nous manifeste le moindre intérêt.
J’avoue avoir du mal à comprendre comment nous pouvons susciter une telle indifférence quand on pense que chez moi, à New York, même en plein Halloween, ma simple apparition guérit instantanément du hoquet et provoque infarctus, crises de panique et chiasse verte chez mes concitoyens.
Mais autant mettre cet anonymat à profit. Et puisque Yahvé, dans Son infinie mansuétude, me fait parler le mandarin, je chope le premier magot qui se pointe pour lui demander la route. C’est un petit vieux tout fripé, en tenue traditionnelle, tellement ridé que Brigitte Macron à côté, c’est Ariana Grande.
— Excusez-moi, grand-père, nous cherchons le marché.
Les fentes qui lui servent d’yeux me dévisagent, puis le papi jaunassou se met à rire, dévoilant des gencives marronnasses sur lesquelles ne subsistent que trois chicots héroïques.
— Le marché ? Tu es un marrant, toi ! De quel marché tu parles ?
— Ben, un marché où on peut acheter des trucs à manger.
Nouvel éclat de rire, suivi d’une violente quinte de toux qui lui fait remonter un molard aussi gras qu’une Bélon.
Désireux de partager ses mucosités, il crache son glaviot sur mes pompes avant de m’expliquer :
— Tu sais combien il y a de marchés à Wuhan, face de riz ? Des dizaines ! Alors comment veux-tu que je vous renseigne, ton copain et toi ?
Il est pris d’une nouvelle toux, qui lui coupe le souffle et le plie en deux.
Merde, il ne va quand même pas me claboter dans les bras, le vieux bonze ? Je vais pour l’aider à se relever. Non pas par bonté d’âme – tu parles que je m’en ramone à deux mains, du nain jaune –, mais par crainte qu’il ne finisse par attirer l’attention des passants. Mais il s’agrippe à mon sweat, libérant par ce geste mon visage, que j’avais pris soin de dissimuler.
Face à ma gueule de décharné, au visage loqueteux, je m’attends aux cris d’épouvante ou au nervous breakdown.
Mais de tout ceci point.
Petit Cachou me dévisage fixement, puis laisse échapper un mystérieux :
— Je vois…
La guenille regarde tout autour de nous d’un air méfiant, puis me fait signe de me pencher. Je m’incline pour arriver à sa hauteur. La vache, je n’avais pas encore capté comment il refoule du goulot, l’ancêtre ! Sérieux, il pue de la gueule comme une hyène constipée.
— Le marché que tu recherches est dans le quartier de Hongshan, non loin d’ici. Je peux vous indiquer où ça se trouve, mais vous devrez attendre la nuit.
Je traduis à Tokū qui s’exclame :
— Chic, un marché nocturne ! C’est tellement pittoresque.
Je ne veux pas doucher l’enthousiasme touristique de mon pote, mais un mystère demeure : pourquoi ce débris a-t-il su quel marché nous recherchions, juste après avoir vu ma tronche de zombie ?
Avec son haleine de lisier, il m’explique en quelques mots où se situe le quartier de Hongshan, me répète que le marché ne se tient qu’à la nuit tombée, et nous abandonne aussi sec.
— Il est quelle heure ?
Tokū hausse les épaules.
— Ça fait bien longtemps que je ne me pose plus ce genre de question, mec. Mais à vue de nez, je dirais qu’on est en milieu d’après-midi.
— OK. Alors on va attendre que la nuit tombe bien sagement, avant de se rendre au marché. Cherchons un coin tranquille.
Nous nous mettons en quête d’une cache où patienter jusqu’à la fin de la journée. De mon passage dans les marines, j’ai retenu que le meilleur moyen d’être discret n’était pas de chercher à disparaître à tout prix, mais au contraire de se fondre dans l’environnement familier des gens.
Je montre à Tokū un groupe de clodos avachis à l’entrée d’une galerie commerciale. Il acquiesce et nous les rejoignons. La plupart sont tellement alcoolisés ou en train de planer qu’ils ne remarquent même pas que nous nous allongeons parmi eux.
Seule une petite nana nous retapisse et semble vouloir monter au renaud. Je m’adresse à elle dans sa langue, ce qui la calme dans un premier temps.
— Qu’est-ce que tu veux ? J’ai tout ce que tu recherches, l’amadoué-je en tapotant la poche de mon blouson. À fumer ? En cachets ? À injecter ?
Banco ! La tox s’approche à quatre pattes, reniflant la bonne affaire. J’écarte un pan de mon bombers, elle n’est plus qu’à quelques centimètres, ses pupilles de junkies rivées sur l’intérieur de mon blouson.
Ce sera sa dernière vision. Je lui passe le bras autour des épaules, comme un vieux camarade, et en deux mouvements, lui brise les cervicales.
Puis j’allonge doucement son corps parmi ses camarades, trop défoncés pour réaliser ce qui vient de se produire.
Tokū se bidonne, et nous finissons de prendre nos aises parmi les loqueteux.
L’après-midi touche à sa fin, quand mon regard est attiré par la vitrine du magasin multimédia en face de nous.
Je rêve ou c’est Wilson à la télé ?
Je me lève et m’approche. Pas de doute, c’est bien son crâne en peau de fesse et son sourire de vendeur de bagnoles d’occasion.
— Wilson ? Mais qu’est-ce que tu fous là ?
Il a franchement l’air de se bidonner, dans son poste de télévision.
— Je te contacte depuis le futur, Orcus. Tu sais, le futur de dans deux ans ?
Je ne comprends pas. Que Wilson apparaisse en cours de mission, ce n’est pas inédit, il l’a déjà fait. Moi-même, tout à l’heure, n’ai-je pas interpellé Yahvé ? Non, ce que je ne comprends pas, c’est pourquoi il se manifeste à moi par le biais d’un écran de télévision, et pas directement ?
— Attends, Orcus, tu vas comprendre : tiens, regarde ce qui est en train de passer à la télé, au moment où je te parle, c’est-à-dire dans deux ans.
Aussitôt, son visage disparaît pour être remplacé par un autre, plus jeune, qui me rappelle vaguement quelqu’un… Attendez, ce costard mal taillé, ces dents du bonheur, cette chevalière de fin de race et cette coupe de gland, ce ne serait pas le président des Français ?
Tokū m’a rejoint.
— Tiens, c’est le banquier bouffeur d’escargots. Tu t’intéresses aux actualités françaises, maintenant ?
Muet, je traduis les informations qui défilent sur l’écran, en dessous du gamin.
— Bordel, murmuré-je, c’est pas vrai.
— Qué pasa, amigo?
— Ce sont des images du futur. Macron parle du confinement en France, pour lutter contre le virus.
— Oui, et alors, c’est normal ? Nous sommes dans un cas typique de fiction basée sur les allers-retours dans le continuum espace-temps. Comme nous n’avons pas encore mis la main sur le pangolin infecté, le futur reste encore le même. Mais dès qu’on aura empêché le virus de se propager, si tu reviens ici, il ne parlera plus de la pandémie, puisqu’elle n’aura jamais existé. Tu comprends ?
— C’est toi qui ne comprends pas, Tokū. Ce ringard vient d’annoncer la prolongation du confinement. Jusqu’au 11 mai !
— Oui, et alors ?
— Et alors ?
Je l’attrape par le colbac et le plaque contre un pilier. Ses jambes s’agitent dans le vide, et il tente en vain de se défaire de ma prise.
— Orcus, merde, qu’est-ce qui te prend ?
— Nous sommes le 14 avril, Tokū, tu sais ce que ça veut dire ?
— C’est la saint-Maxime ?
Je le relâche et il s’affaisse comme les loches de Catherine Deneuve quand elle retire son soutien-nibards.
— Ça veut dire que même en comptant les dimanches libérés, il me reste encore vingt-deux chapitres à écrire, Tokū ! Vingt-deux ! Avec en moyenne quatre calembours par jour, vingt et un coups de théâtre avant le dénouement, de l’action, du sang, un doigt de scatologie, une déferlante de graveleux, quelques références cachées ici ou là juste pour faire plaisir à Thierry Gautier, et surtout, surtout, une intrigue à étirer, encore et encore… Je ne vais jamais y arriver, mec, jamais…
Il se relève et maladroitement, me prend dans ses bras pour me réconforter. Un câlin entre zombies, y a pas à dire, j’innove.
— Allons, allons, pas de défaitisme, Orcus. Je te promets, tu y arriveras. Au pire, on peut appeler le zombie de Gérard de Villiers pour t’aider à l’écrire, si tu veux.
Sa proposition agit comme un électrochoc. Je me redresse et le toise de toute ma morgue.
— Gérard de Villiers, hein ? Et pourquoi pas le zombie de Barbara Cartland, tant que tu y es, elle est à peine froide ! Non mais sans rire, Tokū, si c’est pour me remonter le moral avec des idées aussi connes, tu peux te les garder.
Je m’extrais de la galerie commerciale à grandes enjambées, Tokū sur les talons.
— Mais Orcus, attends-moi ! Où tu vas, comme ça ?
— Au marché de Hongshan, gros malin ! La nuit est tombée, il a dû ouvrir. Tu crois vraiment que c’est un hasard si le vieux de tout à l’heure ne s’est pas évanoui en voyant ma tronche de mort-vivant, et que le marché où nous devons nous rendre se tient la nuit ?
— Je ne sais pas, avoue mon complice, je me suis dit que peut-être, c’étaient des pistes lancées comme ça, à l’aveugle…
— Mes couilles sur ta tête, mec ! Si j’avais voulu lancer des pistes à l’aveugle, j’aurais convoqué le zombie de Ray Charles. Je sais parfaitement où je vais, moi, et je vais le prouver dès demain ! Vous allez voir ce que vous allez voir !
Non mais Gérard de Villiers, sérieusement…