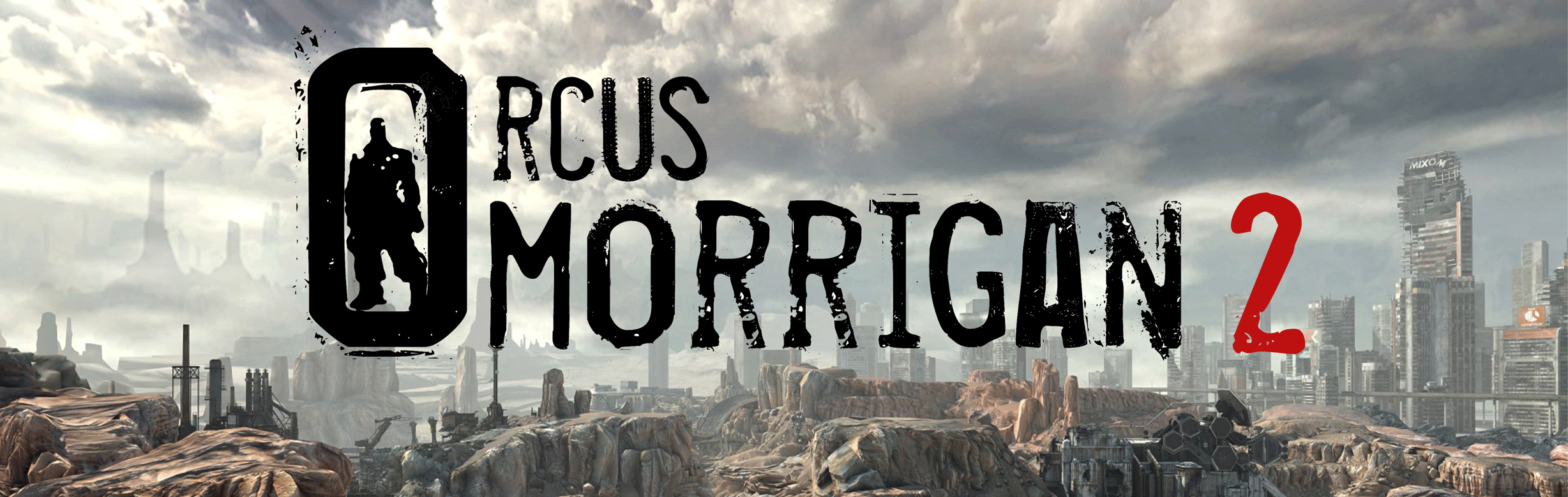« À Combray, tous les jours dès la fin de l’après-midi, longtemps avant le moment où il faudrait me mettre au lit et rester, sans dormir, loin de ma mère et de ma grand’mère, ma chambre à coucher redevenait le point fixe et douloureux de mes préoccupations. On avait bien inventé, pour me distraire les soirs où on me trouvait l’air trop malheureux, de me donner une lanterne magique, dont, en attendant l’heure du dîner, on coiffait ma lampe ; et, à l’instar des premiers architectes et maîtres verriers de l’âge gothique, elle substituait à l’opacité des murs d’impalpables irisations, de surnaturelles apparitions multicolores, où des légendes étaient dépeintes comme dans un vitrail vacillant et momentané. Mais ma tristesse n’en était qu’accrue, parce que rien que le changement d’éclairage détruisait l’habitude que j’avais de ma chambre et grâce à quoi, sauf le supplice du coucher, elle m’était devenue supportable. Maintenant je ne la reconnaissais plus et j’y étais inquiet, comme dans une chambre d’hôtel ou de « chalet », où je fusse arrivé pour la première fois en descendant de chemin de fer.
Au pas saccadé de son cheval, Golo, plein d’un affreux dessein, sortait de la petite forêt triangulaire qui veloutait d’un vert sombre la pente d’une colline, et s’avançait en tressautant vers le château de la pauvre Geneviève de Brabant. Ce château était coupé selon une ligne courbe qui n’était guère que la limite d’un des ovales de verre ménagés dans le châssis qu’on glissait entre les coulisses de la lanterne. Ce n’était qu’un pan de château, et il avait devant lui une lande où rêvait Geneviève qui portait une ceinture bleue. Le château et la lande étaient jaunes, et je n’avais pas attendu de les voir pour connaître leur couleur, car, avant les verres du châssis, la sonorité mordorée du nom de Brabant me l’avait montrée avec évidence. Golo s’arrêtait un instant pour écouter avec tristesse le boniment lu à haute voix par ma grand-tante et qu’il avait l’air de comprendre parfaitement, conformant son attitude, avec une docilité qui n’excluait pas une certaine majesté, aux indications du texte ; puis il s’éloignait du même pas saccadé. Et rien ne pouvait arrêter sa lente chevauchée. Si on bougeait la lanterne, je distinguais le cheval de Golo qui continuait à s’avancer sur les rideaux de la fenêtre, se bombant de leurs plis, descendant dans leurs fentes. Le corps de Golo lui-même, d’une essence aussi surnaturelle que celui de sa monture, s’arrangeait de tout obstacle matériel, de tout objet gênant qu’il rencontrait en le prenant comme ossature et en se le rendant intérieur, fût-ce le bouton de la porte sur lequel s’adaptait aussitôt et surnageait invinciblement sa robe rouge ou sa figure pâle toujours aussi noble et aussi mélancolique, mais qui ne laissait paraître aucun trouble de cette transvertébration.
Certes je leur trouvais du charme à ces brillantes projections qui semblaient émaner d’un passé mérovingien et promenaient autour de moi des reflets d’histoire si anciens. Mais je ne peux dire quel malaise me causait pourtant cette intrusion du mystère et de la beauté dans une chambre que j’avais fini par remplir de mon moi au point de ne pas faire plus attention à elle qu’à lui-même. L’influence anesthésiante de l’habitude ayant cessé, je me mettais à penser, à sentir, choses si tristes. Ce bouton de la porte de ma chambre, qui différait pour moi de tous les autres boutons de porte du monde en ceci qu’il semblait ouvrir tout seul, sans que j’eusse besoin de le tourner, tant le maniement m’en était devenu inconscient, le voilà qui servait maintenant de corps astral à Golo. Et dès qu’on sonnait le dîner, j’avais hâte de courir à la salle à manger, où la grosse lampe de la suspension, ignorante de Golo et de Barbe-Bleue, et qui connaissait mes parents et le bœuf à la casserole, donnait sa lumière de tous les soirs, et de tomber dans les bras de maman que les malheurs de Geneviève de Brabant me rendaient plus chère, tandis que les crimes de Golo me faisaient examiner ma propre conscience avec plus de scrupules. »
POISSON D’AVRIL !!
Oui, je sais, vous attendiez tous de savoir ce que j’ai vu à travers les fenêtres dessinées par Wilson. Et je peux vous dire que ça vaut son pesant d’asticots. Seulement, pile au moment où j’allais vous le révéler, un collègue zombie que je n’avais encore jamais vu est arrivé. Pas le genre golgoth, hein ! Plutôt le gabarit freluquet souffreteux, avec petite moustache de dandy. Il s’est approché et m’a dit :
— Longtemps, je me suis décomposé de bonne heure.
— Et qu’est-ce que tu veux que ça me foute ? que j’y ai répondu. T’as pas un caisson de régénération, comme tout le monde ?
— Je m’appelle Marcel, qu’il me dit après. Et je suis un zombie écrivain.
Là, j’ai ricané velu. Parce que que les choses soient claires, les deux seuls écrivains zombies que je connaisse, c’est Michel Houellebecq et ma pomme.
— Dis donc, bonhomme, que j’ai rétorqué, faudrait voir à pas se moucher du coude. On s’improvise pas écrivain juste parce qu’on a un prénom de vieux et une fleur fanée à la boutonnière. Montre voir un peu ce que tu donnes, un stylo à la main.
Là, d’un jet, Marcel m’a pondu la compo franc que je vous ai recopiée juste au-dessus. Putain, ce style imbitable ! Avouez qu’il y a de quoi se poignarder l’oignon avec une merguez, non ?
Du coup, je l’ai renvoyé se faire cuire des madeleines à grands coups de rangers dans le derche, le Marcel. C’est vrai quoi, on a autre chose à foutre que de lire ses souvenirs de vacances. Parce que vous, ce que vous voulez, c’est savoir ce que j’ai vu derrière ces portails de l’enfer.
Seulement, à cause de l’autre casse-burnes, j’ai fini mon heure quotidienne de présence, et dès demain, je vais devoir cavaler à la recherche du temps perdu.
Mais pas de bile, le 1er avril sera passé !
Envie de (re)lire « Manhattan Carnage », le premier tome des aventures d’Orcus Morrigan ? Lien de téléchargement gratuit vers ce chef-d’œuvre en péril : https://we.tl/t-udgfv9l5Ux